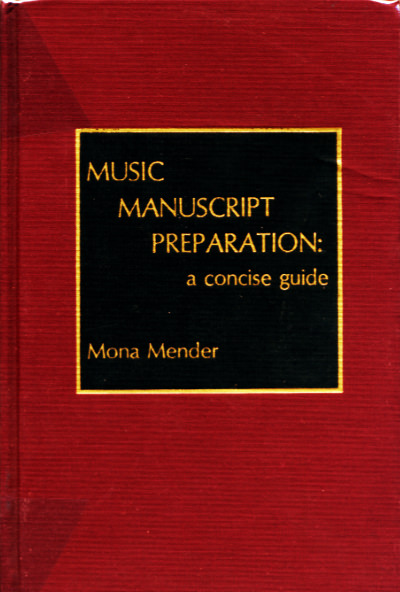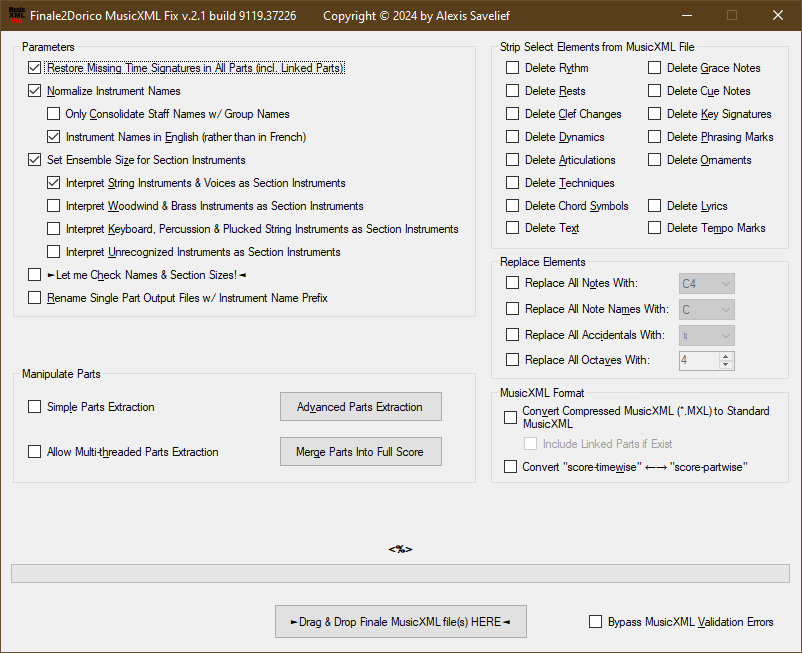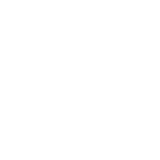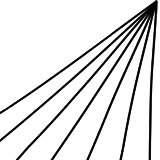J’ai encore le disque 45 tours d’époque de la bande originale du film Il Était une Fois dans l’Ouest. Même si je n’écoute plus guère de disque vinyles aujourd’hui, je n’ai jamais réussi à m’en séparer. Je l’ai récupéré voilà des années, d’une personne de ma famille qui l’avait acheté à l’époque de la sortie du film, en 1968.
Il y a plus longtemps encore, enfant, lorsque j’apprenais la musique (le violoncelle, dans mon cas), l’orchestre de la petite école de musique dans laquelle je jouais avait pour habitude d’inclure presque systématiquement une partition d’Ennio Morricone dans son programme. Voilà comment j’ai été exposé pour la première fois à sa musique : non par les films qu’il a embellis de ses partitions (et parfois même, sauvés…), mais par sa musique-même. Ce n’est que bien plus tard que j’ai vu, enfin, quelques-uns de ses films.
C’est donc tout naturellement — mais sans nostalgie — que, lorsque j’ai découvert la bande-annonce de Ennio au cinéma il y a quelque temps, de manière tout à fait inattendue, j’ai su que je ne pourrais rater ce film pour rien au monde. Et qu’il est rare que j’attende la sortie d’un film aujourd’hui avec un brin d’excitation !
Le réalisateur de Ennio, c’est Giuseppe Tornatore, qui n’est autre que le réalisateur de Cinéma Paradiso (1988), auquel Morricone avait prêté sa musique. Mais aussi de Une Pure Formalité (1994), Marchand de Rêves (1995), La Légende du Pianiste sur l’Océan (1998)… et beaucoup d’autres (16 films ensemble au total) !
Qui serait donc mieux qualifié que lui pour rendre justice au sujet de ce documentaire, le grand compositeur de musique de film Ennio Morricone ? Qui, mieux que lui, bénéficierait déjà de la confiance et du respect mutuel des deux artistes ?
Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que trouver un cinéma qui projette Ennio relève de la gageure, tant les séances se font rares ; pourtant, pas moins de cinq cinémas se trouvent à proximité de chez moi, mais un seul le projetait, un cinéma d’art et essai, proposant un choix de séances plutôt restreint !
D’ailleurs, détail révélateur, à la fin du film, pratiquement tous les spectateurs sont restés dans la salle jusqu’à la fin du générique, ce qui met bien en évidence le fait que ce film ne s’adresse qu’à une frange (hélas) très limitée du public plus ou moins cinéphile. Un pari risqué, donc, de proposer la sortie d’un documentaire de niche en salles de cinéma, à l’heure où la sortie de tant d’autres films, même grand public, se reporte désormais sur les plateformes de streaming.
Ennio, intrinsèquement et avant même la projection de la moindre image, commence par un bel hommage au compositeur qu’il va suivre tout du long. En effet, la date de sortie du film, le 6 juillet 2022, coïncide avec la date anniversaire de la disparition du Maître, le 6 juillet 2020.
Première surprise : malgré sa longueur (2h36), la durée du film n’est pas un obstacle à l’intérêt de son sujet. Au contraire, je pense qu’il aurait été difficile de couper quoi que ce soit sans perdre en profondeur dans la (très riche) carrière de Morricone et ses (nombreuses) facettes, y compris hors-cinéma. Au final, ces 2h30+ passent plus vite que n’importe quel blockbuster.
Mieux : je suis sorti de la salle en me sentant enrichi, ce qui ne m’arrive pas si souvent. J’étais accompagné d’une personne qui n’a rien à voir avec le milieu musical, n’a pas d’intérêt particulier pour la musique de film, pourtant celle-ci a également trouvé que le film est passionnant, et captivant de bout en bout. Elle envisage même de retourner le voir une seconde fois, dans quelque temps !
Deuxième surprise : ce film documentaire est à mon avis un vrai film documentaire de cinéma. Je m’explique : étant donné la générosité des extraits de films présentés pour illustrer le propos, mais aussi les très beaux plans de Morricone (par exemple, ceux au cours desquels il dirige sa musique en esquissant des gestes dans le vide, dans son bureau de travail, porté par une caméra en travelling avec l’enregistrement de la partition musicale superposé aux images), Ennio gagne à être vu au cinéma, sur grand écran.
Troisième surprise : Ennio, malgré sa durée généreuse, ne peut qu’aborder une fraction de la production musicale de Morricone, préférant se concentrer sur ses différentes périodes, plutôt que chercher l’exhaustivité de sa cinématographie.
En effet, après ces 2h30 de cinéma, au défilement du générique, nous réalisons que nous n’avons qu’effleuré la surface de sa production (une cinquantaine de ses partitions pour le cinéma sont évoquées explicitement, sur un total de plus de 500 — soit à peine 10% de ses bandes originales !) Par exemple, on n’y parle ni de Wolf (1994), ni de l’étrange Une Pure Formalité (1994 également, du même Giuseppe Tornatore que le présent film). Mais tous ses films majeurs ou, en tout cas, les plus connus, sont abordés.
Le documentaire fait la part belle aux images d’archives, où l’on y voit par exemple Morricone tout jeune jouer de la trompette, et le montage fait preuve d’une belle maîtrise dans son entrelac d’extraits musicaux et filmiques, d’extraits de concerts, d’entretiens avec Morricone lui-même, mais aussi d’intervenants plus ou moins proches du Maestro, qu’ils soient d’anciens collaborateurs ou des musiciens/réalisateurs (parmi lesquels, John Williams et… arf ! Hans Zimmer…), influencés aujourd’hui encore par la musique et le parcours d’Ennio.
Mais, si le film est en effet constellé en contrepoint d’interventions d’intervenants divers, afin de multiplier les points de vue plus ou moins objectifs et d’apporter un éclairage à certains souvenirs évoqués par Morricone, Giuseppe Tornatore fait le choix, à mon avis payant, de toujours garder pour fil conducteur le Maestro, centrant son documentaire autour des images de Morricone lui-même, nous livrant ses souvenirs et ses anecdotes, parfois avec beaucoup d’émotion manifeste.
Le film traite son sujet dans l’ordre chronologique, ce qui lui confère une grande lisibilité et permet de dégager les grandes étapes du parcours et de la construction du jeune (puis moins jeune) Morricone.
Morricone débute son apprentissage musicale par la trompette, forcé par son père. Ayant obtenu un mauvais résultat en solfège, ce dernier le contraint à travailler pendant les vacances pour rattraper son retard. Bien vite contraint de gagner sa vie pour faire subsister sa famille, le petit Ennio vit cette période comme une grande humiliation.
Mais il commence en parallèle à se former au contrepoint, à l’écriture, puis à la composition. C’est le Maître Goffredo Petrassi que choisit Morricone, qui lui enseigne les rudiments de la composition pendant dix ans. Morricone restera d’ailleurs toute sa vie proche de son ancien Maître.
Il se fait vite connaître pour ses arrangements toujours inventifs, réalisés pour les grands chanteurs de l’époque, mais qu’il signe sous pseudonyme, entre autres afin de passer sous les radars de Petrassi, car ce dernier soutient la cause d’une musique “pure” (quoique celui-ci se soit également adonné au cinéma à l’occasion)…
Mais si Morricone verse alors dans la musique populaire, c’est aussi un compositeur qui ne rechigne pas à s’adonner également à la musique avant-gardiste, en particulier en constituant avec des collègues compositeurs le groupe expérimental “Nuova Consonanza”, qui explore de nouvelles sonorités et de nouvelles conceptions plus abstraites de la musique. Ce collectif cherche notamment à faire sonner les instrument différemment de leur couleur propre. On y voit par exemple Morricone jouer sur sa trompette comme des miaulements.
Enfin, en 1961, à l’âge de 33 ans, il signe pour la première fois une bande originale de film sous son vrai nom : Il Federale, de Luciano Salce. S’enchaînent alors les projets, et s’ensuivent en particulier ses premiers westerns spaghetti, dont nombre d’entre eux pour Sergio Leone, ancien camarade de classe.
Mais pour lui, écrire de la musique de film reste au départ une conception musicale qu’il considère comme mineure. Il raconte d’ailleurs comment, en 1960, il disait à sa femme qu’en 1970 il arrêterait d’écrire de la musique pour le cinéma. En 1970, qu’il arrêterait en 1980. En 1980, qu’il arrêterait en 1990… Pour conclure : “Aujourd’hui, je ne dis plus rien !”
Au détour de quelque anecdote presque tragique, on y découvre aussi l’hypocrisie ou la possessivité créative de certains partenaires de travail, qui lui font manquer quelques projets significatifs, parmi lesquels La Bible (1966) de John Huston, ou Orange Mécanique (1976) de Stanley Kubrick… On se prendrait presque à rêver de l’essor et du tour différent qu’aurait pu prendre sa carrière s’il avait pu composer la musique de ces films…
On apprend que la partition du film Le Clan des Siciliens (1969) de Henri Verneuil, lui fut particulièrement difficile à composer. Mais aussi que Mission (1986) de Roland Joffé, est un film que Morricone avait refusé initialement, avant de revenir lui-même à la charge auprès de Joffé…
J’ai aussi été frappé de la lucidité dont semble faire preuve Morricone. On découvre d’ailleurs que le compositeur n’hésitait pas, au besoin, à s’opposer aux souhaits des réalisateurs, même si certaines de ses capitulations (“Puisque tu aimes ces conneries-là, je vais te les écrire, moi, tes conneries !”) lui ont valu certains de ses grands succès !
Et pourtant, malgré sa carrière monumentale, qui forcerait le respect même si celle-ci se réduisait à sa moitié, nommé aux Oscars rien mois que six fois, Ennio ne remportera finalement un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière que tardivement, en 2007, puis en 2016, un Oscar de la meilleure musique de film pour Les Huit Salopards, de Quentin Tarantino.
Comme quoi, une fois de plus, cela relativise quelque peu la légitimité de toutes ces récompenses, prix et distinctions, décernés sans doute sur la base d’autres critères… Beaucoup sont passés sur l’autel du manque de discernement, de clairvoyance et de vision des jurys de tous ces Prix. L’Histoire se charge alors de corriger ces injustices ; que l’on se souvienne de Maurice Ravel échouant successivement cinq fois au Prix de Rome avant de capituler. Mais qui se souvient aujourd’hui des compositeurs consacrés par l’Académie face à lui ?… Que reste-t-il de leur musique ?
Plutôt que de clore le film sur le décès d’Ennio Morricone il y a tout juste deux ans, Tornatore choisit de consacrer la dernière partie de son film à l’héritage que nous laisse Morricone, et l’influence profonde qu’il a encore aujourd’hui, et peut-être plus que jamais, sur une partie importante de la culture populaire et, plus important encore, peut-être, sur les compositeurs, musiciens et réalisateurs de tous bords.
Certes, vers la fin, le montage du film ne parvient pas à éviter l’écueil de la critique dythirambique, sans recul, de la part de certains de ses intervenants (“Sa musique sera toujours là dans 200 ans”, “Ennio est un génie”), ce qu’heureusement, d’autres intervenants se permettent de modérer plus raisonnablement. Admiration n’empêche pas raison garder, et seul l’avenir — quand plus aucun de nous ne sera là — permettra de trancher si la musique de Morricone est réellement “éternelle”. Quoi qu’il en soit, l’empreinte indélébile que laisse Morricone sur la musique de film, en particulier la musique de film européenne, est indubitable, et c’est déjà un bel accomplissement.
Le film aurait nécessité cinq ans de travail à Giuseppe Tornatore et, face à l’ampleur du parcours de Morricone, je comprends que l’envergure du sujet ait requis un temps de gestation aussi long. Au final, Ennio est une vraie réussite. Pari réussi !
Vous l’avez compris : j’ai passé un excellent moment de cinéma, et je recommande ce film à tout passionné de musique de film, de cinéma, et même de musique tout court.
John Williams bénéficiera-t-il un jour d’un tel traitement, dans un film qui pourrait s’intituler John ou Johnny, en référence à son surnom de l’époque où il était encore pianiste de jazz ?… Le Maître n’est plus tout jeune… c’est le moment, avis aux réalisateurs !